Comment es-tu venu à la photographie ?
Zim Moriarty : Je me suis immergé dans la photographie pendant mes études à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. Dès le premier jour de cours, on apprenait sur de vieux appareils reflex Nikkormat, simples et primitifs, uniquement équipés d’objectifs fixes 50 mm: vitesse d’obturation, diaphragme et profondeur de champ, mise au point, cadrage. Les fondamentaux. Mais à l’origine je suis dessinateur, depuis aussi loin que je me souvienne, je dessine. Alors la photographie est quelque chose que j’ai essayé de développer comme un contrepoint au dessin. Qui le prolonge, et le remplace parfois. C’est comme une danse entre les deux.
Je me souviens de l’enseignement d’un photographe, Thierry Nava, qui nous faisait construire nos sténopés à partir de boîtes de thé métalliques peintes en noir, avec un objectif fabriqué à partir de lames de rasoirs entre-croisées qui permettaient de doser la lumière… ce travail à la « camera oscura », lent, flou et pictural, m’a énormément marqué. il fallait laisser la boîte en place, objectif ouvert parfois pendant 7 heures d’affilée, pour saisir des paysages nocturnes, des choses invisibles à l’œil nu. Un artisanat de l’image, lent et méditatif. Et en cela, proche du dessin.
Discographie
MoriartyMoriarty – Echoes from the Borderline
Quel matériel utilises-tu ? On s’est rapidement croisé à Amiens il y a quelques années et j’ai cru apercevoir un Leica.
Je suis assez simple dans mon rapport aux objets, que ce soient des instruments de dessin, musicaux ou photographiques… j’aime les appareils très simples, sans aucun automatisme. S’il y en a un qui me convient, une fois dompté, je le garde et ne photographie plus qu’avec celui-là.
Au début j’ai appris avec un reflex Canon AE-1, très robuste, increvable, un vrai tank. Mais depuis dix ans j’utilise un Leica M6, avec un objectif Summicron 35 mm. J’alterne parfois avec un Summicron 50 mm, pour les portraits ou pour changer de distance. et parfois j’utilise aussi un drôle d’objectif-sténopé artisanal qui permet de transformer le boitier du M6 en camera oscura (absurde, diront certains!). J’ai utilisé le Leica M6 pour toute la tournée de Moriarty, je l’avais à mon épaule pendant ces dix dernières années, pour garder les traces argentiques de nos 800 concerts… Le contraste et la luminosité de la lentille, la manipulation simple, rapide et intuitive du boîtier, en faisaient le compagnon idéal de notre son, du grain de nos instruments.
Tu développes toi même tes pellicules ? Tu tires tes photographies ?
A l’école d’art, puis à l’école d’architecture, j’étais tout le temps fourré dans le labo, à développer et tirer mes photos. Mais depuis la tournée de Moriarty, tout le temps sur la route, je n’avais plus ni le temps ni l’équipement pour me livrer à tout ça… donc j’ai fait confiance à un petit laboratoire à Paris pour développer les films, et à un ami et collaborateur photographe, Clément Deuve, pour les tirages. Nous discutons beaucoup des images, de leur impact et de leur qualité, il connaît exactement mes envies et choix en termes de contraste et de densité des tirages, et il a une exigence et une précision extrême dans son travail, ce qui fait que je lui confie toujours les tirages et agrandissements des photographies que je choisis.
Comment as-tu sélectionné les photographies qui figurent dans le livret ?
C’était un processus très long, puisqu’il fallait replonger dans dix années de films accumulés, soit près de 1100 négatifs, 40000 photos… et n’en garder que 40. Une photo sur 10000. J’avais procédé à des editings successifs au fil des années, afin d’alimenter notre journal de tournée, sur le site de Moriarty notamment ; ça m’a permis d’identifier quelques photos qui faisaient l’unanimité dans le groupe, qui transmettaient cette mémoire collective des concerts et des voyages : les images qui restent au bout de plusieurs années, les seules qui surnagent dans le flux visuel continu, l’écume de la tournée. L’editing final, je l’ai finalisé avec l’aide de Clément Deuve, qui m’a aidé à trancher dans la masse de photos, pour composer des couples d’images fonctionnant sur les double-pages du livret, tout en suivant une narration anti-chronologique (les photos s’enchaînent en remontant le temps depuis 2015, année après année, jusqu’en 2005, aux toutes premières dates de tournée). On a aussi tenté de respecter l’individualité de chaque musicien, les images collectives du groupe, le rythme des voyages, entre moments d’attente, contemplatifs, les échappées sur les routes, dans les airs ou les trains. Le sentiment de fuite en avant.
Il y quasiment une dizaine d’années de clichés. Tu vois une évolution dans ton travail ? Elle est liée à l’évolution du groupe ?
Oui c’est tout un bloc de temps, cette série photographique. Je me rappelle du sentiment des jours qui filent comme du sable entre les doigts, au fil des kilomètres. Les semaines, les mois qui disparaissent, engloutis dans le chaos de l’oubli, sitôt vécus. Et la nécessité de capturer quelques éclairs, quelques visages et atmosphères, tout ce que le cerveau ne réussit pas à conserver. Peut-être pour garder un semblant d’ordre mental. Le fait de photographier en argentique, de ne pas voir immédiatement les clichés, mais de devoir attendre parfois des mois avant de les développer, était paradoxalement crucial dans ce travail de mémoire artificielle. Au retour des voyages je récupérais les négatifs, et j’essayais de reconstituer ce qui s’était passé à partir de l’ordre des photos sur les films. Une espèce d’énigme visuelle. ça me permettait de remettre un nom sur ces lieux traversés hâtivement, sur ces visages fugitifs, rencontres fortuites et éphémères.
En reparcourant l’ensemble de cette archive visuelle, on a été frappés, bien sûr, par le passage du temps sur les visages, des kilomètres sur les corps. Je vois aussi l’évolution des photographies, de cadrages et de distances plus statiques au début, vers une manière de photographier plus rapide, plus détachée peut-être. Qui s’apparente effectivement à l’énergie du groupe après une décennie sur la route!
Tu prends des photos quotidiennement ?
Je dessine quotidiennement, j’ai toujours un carnet dans la poche pour dessiner à tout instant ; ou au pire, un bout de journal ou un emballage, une serviette ou une nappe de table pour griffonner un croquis. Je photographie aussi compulsivement, mais pas tous les jours. En tournée c’était une sorte de manie, de discipline, pour garder le compte des jours. Mais en ce moment je laisse le Leica se reposer.
A quel moment as-tu pris la photographie Hotel Pacific (01/2009) ? Elle est splendide ?
Le portrait d’Eric dans le port de Hambourg ? Elle m’est très chère. 24 Janvier 2009, on venait de démarrer notre première tournée allemande, par un concert au Kampnagel de Hambourg, un concert très intense dans une ancienne usine, avec un public incandescent. On devait avoir du mal à redescendre. Alors après avoir posé nos affaires à l’hôtel Pacific, Eric notre batteur m’a entraîné dans une marche nocturne et glacée, vers l’Elbe… il était hanté par une réminiscence précise : le souvenir d’avoir mangé des filets de harengs « maatjes » à l’aube, à un des étals du marché aux poissons qui longent les grands bassins du port industriel. Et il ne voulait pas se coucher avant d’avoir trouvé ces satanés maatjes – parfois un souvenir olfactif ou gustatif vous taraude tellement qu’il vous fait oublier la fatigue, le manque de sommeil et les 900 km roulés la veille ; il y a la madeleine de Proust, et les filets de hareng d’Eric. En s’approchant de cet étrange graal, j’ai vu le visage d’Eric s’éclairer sous les réverbères du quai, son visage ressortait comme un masque contre la masse noire et mouvante de l’eau, contre les carènes titanesques des chantiers navals. A ce moment-là j’ai vu dans le viseur, plus qu’Eric lui-même, un personnage filmique, une apparition. Il ne faisait qu’un avec ce port. C’était une de ces nuits blanches de tournée, interminables, mûes par une intuition étrange et insomniaque: la certitude que ces instants ne se reproduiraient plus mais resteraient gravés indélébilement, qu’il fallait les vivre jusqu’à la dernière goutte d’énergie. Quelques minutes après, en remontant vers le Ripperbahn, nous arrivions devant un vieux bar nocturne, qui était en train de fermer ses portes. Au dessus de la porte était écrit en grands lettres cursives et anguleuses : « Café Lehmitz »…
Quels sont tes clichés préférés de ce livret ?
En le feuilletant, je crois que de façon très intime, ce sont les photographies qui me font immédiatement ressurgir les sensations physiques de l’instant où elles ont été capturées. Dans les deux images du Québec, celles du St-Laurent gelé et du groupe marchant sur le Lac Mégantic, je ressens la morsure du métal du Leica dans mes doigts, la claque du blizzard insoutenable sur les jambes et le visage. La photographie de Melbourne me fait instantanément ressentir le rayonnement du soleil australien, le vertige devant l’immensité de ce continent. Dans celle de la rue Shijo-Dori à Kyoto, je retrouve la chaleur moite du Japon en juin, et la sensation d’équilibre instable, sur le fil, au moment de prendre la photo d’une main tout en tenant le guidon du vélo de l’autre, à toute vitesse, pour capturer la silhouette d’Arthur qui filait devant moi le long des enfilades éblouissantes des taxis. A travers la photo de Brooklyn, je ressens l’anticipation euphorique, en sentant la neige fouetter mon visage à l’instant de sortir sur l’escalier de secours, pour retrouver les autres membres du groupe et jouer notre premier concert en terre américaine, au club Zebulon.
Je crois que je suis fasciné par cette capacité étrange qu’a parfois la photographie de condenser, de préserver une forme d’énergie vitale, qu’elle relâche des années après, en réanimant ainsi des sensations corporelles oubliées.
Comment concilies-tu le fait d’être à la fois dans un groupe et dans un être, au final, le photographe officiel ?
On s’est toujours dit que le son, la musique, l’image et les objets sont les émanations d’une même idée, d’un même ressenti. Il n’y a pas fondamentalement de différence entre tous ces médiums, ce sont juste des outils, les formes par lesquelles les idées se matérialisent. Alors une intuition peut trouver sa forme dans des notes de musique ou la composition d’une image. Je crois que c’est assez synesthésique tout ça, passer d’un mode d’expression à l’autre, ça permet juste de ressentir le grain de l’image comme le grain d’un son ; ça permet d’écrire des chansons et de prendre des photos qui transforment le réel en fiction, parfois.
Faire tout ça en même temps, c’est juste assez compliqué parce qu’on n’a que deux mains. Alors souvent ça s’emmêle.
Moriarty - Echoes from the Borderline
Echoes from the Bordeline de Moriarty est disponible via Air Rytmo.
- History of violence
- Long live the (d)evil
- Motel (feat mama rosin)
- Milena
- Beasty jane
- St james infirmary
- Nobody home
- Serial fields
- Julie's golg candy cane tale
- Ramblin' man
- Fireday (feat moroba koita & pedro kouyate)
- Soon will come too soon
- Oshkosk bend
- When I ride
- Where is the light
- Clementine
- Chocolate jesus
- Private lily (feat moriba koita & pedro kouyate)
- Isabella
- Cottonflower
- La chanson de margaret
- Tagono ura
- Jimmy
- Roboto hoshii
- Whiteman's ballad
- Long is the night

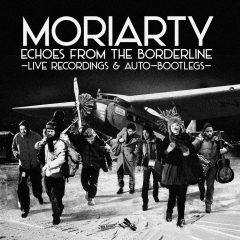








 Et si Gareth Halliday nous en collait une ?
Et si Gareth Halliday nous en collait une ? [1997 – 2017] La grande parade des The Frank & Walters
[1997 – 2017] La grande parade des The Frank & Walters